Prévoir l'intonation d'une phrase française
© François Lonchamp - 2007
Prévoir l'intonation, c'est prévoir l'évolution de la ligne mélodique de la voix,
c'est-à-dire les montées et descentes de la voix (physiquement l'évolution de la fréquence fondamentale
(Fo) des vibrations des cordes vocales) à l'échelle d'une phrase ou d'un énoncé.
A l'inverse de la plupart des autres langues européennes, le français ne possède pas d'accent tonique
lexical(mais fait appel à un accent discursif mentionné plus loin).
En anglais, par exemple, les dictionnaires notent la position de l'accent tonique, souvent à l'aide du
signe ' devant la syllabe accentuée :
'photograph
pho'tographer
photo 'graphic
La syllabe qui reçoit l'accent tonique est plus intense que les autres, donc plus distincte,
et elle est aussi souvent plus longue.
En un mot, l'intonation du français est régie pour l'essentiel par des facteurs rythmiques,
des contraintes syntaxiques, et par l'association d'un répertoire limité de contours intonatifs avec
les valeurs discursives de thème et de rhème. Il ne s'agit donc pas d'une hiérarchisation des pics accentuels
liés aux éléments lexicaux comme dans les langues à accent tonique lexical.
1 L'intonation de la phrase canonique
sujet-verbe-complément(s)-circonstant(s)
Une phrase nucléaire canonique est entièrement rhématique : aucune information n'a été fournie
par le cotexte ou contexte. C'est typiquement le premier énoncé d'un discours
(1) [tu sais quoi ?]
L'appartement de Jean-Claude a été cambriolé hier soir.
La ou les lignes mélodiques licites d'un énoncé canonique peuvent être générées (quasi-)automatiquement
par un petit nombre de règles faisant référence à la structure syntaxique de cet énoncé, et à une règle
rythmique.
En bref, les syllabes des lexèmes composant un énoncé sont regroupées pour former des
mots prosodiques, qui sont regroupés à leur tour pour former des groupes prosodiques
Concernant les syllabes,
on distinguera les syllabes constitutives des
- mots lexicaux (substantifs, verbes, adjectifs, adverbes 'lourds' dérivés d'adjectifs) :
ces syllabes seront marquées ici par '-'
- mots grammaticaux (déterminants, pronoms, auxiliaires, prépositions, conjonctions,
adverbes 'légers' ...) : ces syllabes seront marquées ici par 'Ø'
Règles de regroupement
- Un mot prosodique (noté ici entre /.../) est formé d'un
mot lexical et des mots grammaticaux qui le précédent éventuellement
(2) Les étudiants se sont mis en grève la semaine dernière
/ Ø -
- - / Ø
Ø -
/ Ø -
/ Ø
-
- /
- - /
Cette règle découle essentiellement du fait qu'en français, dans la plupart des
cas, les mots grammaticaux (ou fonctionnels) précèdent les mots
lexicaux sur lesquels ils portent : l'article précède le substantifs,
l'auxiliaire le verbe, la préposition le groupe nominal, etc.
- Les mots prosodiques se regroupent à leur tour en
groupes prosodiques.
Un groupe prosodique est composé d'un ou de plusieurs mots prosodiques contigus.
Ce regroupement obéit à un ensemble de règles décrites plus loin.
Chaque groupe prosodique est doté d'un contour intonatif.
Voici l'une des réalisations possibles de (2):
(3) [/ Les étudiants / se sont mis / en grève /] [/ la semaine / dernière /]
Deux groupes prosodiques (notés ici entre [...]) regroupent respectivement les 3
premiers, et les 2 derniers, mots prosodiques.
2 Inventaire des contours intonatifs essentiels
2.1 Continuation Majeure (CM)
Elle sera notée ici par √ à la fin du groupe prosodique.
(4) [L'appartement de Jean-Claude √]
[a été cambriolé hier soir]
Les caractéristiques d'une CM sont
- Attaque à une hauteur mélodique
moyenne
- Montée mélodique marquée sur (au moins) la syllabe finale du groupe prosodique,
et rupture mélodique avec le contour suivant.
- Une pause n'est réalisée que lorsque
le débit d'élocution est très lent
2.2- Contour de Finalité
(CF) : (noté ici \ à la fin du groupe prosodique)
(5) (tu
veux aller au ciné ?) Non
\ Pas
question \ Je
suis trop fatigué \
- Chute mélodique vers la base du
registre du locuteur, portant (au moins) sur la syllabe finale.
NB : La terminologie utilisée ici est celle proposée par
P. Delattre il y a 60 ans
3 - Assignation
des contours
-
Lorsque une phrase est composée de deux groupes prosodiques ou plus,
tous les groupes sauf le dernier reçoivent un contour de continuation
majeure (CM).
- Le dernier (ou l'unique) groupe de la phrase reçoit un contour de
finalité (CF)
• La règle
d'eurythmie
En
concaténant les mots prosodiques pour former les groupes prosodiques,
on cherche à équilibrer le nombre de syllabes contenues dans chaque
groupe prosodique.
C'est la règle d'eurythmie de Dell (1984). Le nombre
de syllabes par groupe tend donc vers une même valeur. Ce paramètre est
fixé par le locuteur et covarie avec le débit d'élocution : 7 syllabes
par groupe pour un débit moyen, 4 à 5 en débit lent, 10 ou même plus en
débit rapide.
Sauf dans les cas particuliers décrits ci-dessous,
un groupe prosodique est obtenu par la concaténation de mots
prosodiques successifs jusqu'à ce que le nombre de syllabes requis soit
atteint, quelles que soient les catégories ou les fonctions syntaxiques
impliquées.
(6) (Pour
demain), j'ai prévu un poulet √ et une salade \
(7) (Pour
demain), la météo √ prévoit de la pluie \
Dans
l'exemple (6), le premier groupe rassemble, pour des raisons
d'eurythmie, le sujet pronominal, le prédicat verbal et la première
partie du complément, le second ne contenant que la seconde partie du
complément. En (7), le premier groupe ne contient que le sujet.
Mais la règle d'eurythmie ne s'applique pas dans les cas décrits ci-dessous
• Contrainte
syntaxique n°1: la règle du 'fils droit et de l'oncle'
Un
groupe prosodique ne peut être composé exclusivement d'un couple
d'éléments en position 'fils droit' et 'oncle' sur l'arbre syntagmatique.
L'arbre
syntagmatique pertinent est l'arbre à branchement binaire dont
les' feuilles' sont les mots prosodiques.
(8) (Tu
sais) *Jean-Michel a acheté√ des fleurs ce matin \
NB : * note un énoncé impossible, ?? une forte déviance
Ce découpage est interdit car il regroupe le fils (ou frère) droit 'des fleurs'
avec son oncle 'ce matin' (Fig.1)
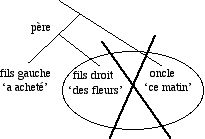 Fig. 1
Fig. 1
Les découpages non eurythmiques (9) ou (10) sont seuls possibles
(9) (tu
sais) Jean-Michel a acheté des fleurs √ ce matin \
(10) (tu
sais) Jean-Michel √ a acheté des fleurs ce matin
(9) est acceptable car le groupe final contient les deux fils, donc le
noeud père, et l'oncle.
L'énoncé (11) founit un second exemple de l'application de cette contrainte
(11) a
*L'arrière-petit-fils √ de Jean est malade \
b L'arrière-petit-fils de Jean
√ est malade \
En voici un troisième
(32) a *Il
a décidé de passer √ son permis cet été \
b Il
a décidé de passer son permis√ cet été \
Dans ce cas, 'cet été' est le grand-oncle de 'son permis'. La contrainte doit s'entendre au sens large.
Remarquons que l'intonation ne lève pas à coup sûr l'ambiguïté de
rattachement d'un syntagme prépositionnel.
(12)
Jean-Michel voit les fleurs du balcon
Interprétation A : Jean-Michel voit les fleurs depuis le balcon (Fig.2)
Interprétation B :
Jean-Michel voit les fleurs qui sont sur le balcon (Fig. 3)
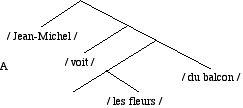 Fig. 2
Fig. 2
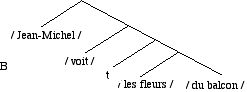 Fig. 3
Fig. 3
Avec la lecture B, les découpages (13a), (13b) et (13c) sont licites,
la règle d'eurythmie favorisant (13a).
(13)
a
Jean-Michel voit√ les fleurs du balcon \
b
Jean-Michel voit les fleurs √ du balcon \
c
Jean-Michel√ voit les fleurs du balcon \
Mais avec
la lecture A, le découpage eurythmique (13a) est exclu, (13b) et (13c)
étant seuls possibles.
Comme deux phrases structurellement distinctes peuvent
recevoir la même suite de contours mélodiques, ici (13b) et (13c), il
est
clair que la prosodie ne lève pas à coup sûr l'ambiguïté structurelle.
NB: La Continuation
Mineure (Cm): ^, v
Si
la taille d'un groupe prosodique dépasse 4 à 5 syllabes, comme c'est
souvent le cas lorsque cette contrainte s'applique, le groupe peut se
scinder en deux parties, dont la première, la continuation mineure (Cm)
est
-
terminée par une légère montée (notée ici ^) ou une légère descente (notée ici v), sans pause ultérieure
: on emploie une Cm montante devant un CF, une Cm descendante devant
une CM (cf. la règle d'inversion des pentes de Ph. Martin
(1975)).
- sans rupture mélodique avec la partie finale (contour 'en dos d'âne'
ou 'en auge')
Exemple : scission d'un contour de finalité de 6 syllabes
(14)
(Tu sais) Jean-Michel ^ est malade \
Exemple : scission d'une CM longue exigée par la contrainte du fils
droit et de l'oncle
(15) (Tu
sais quoi?) La soeur de Jean-Michel v et sa copine √ sont déjà là \
La Cm peut se produire sur un mot grammatical ou même au sein d'un mot
lexical
(16)
(C'est sûr) Michel le lui ^ dira \
(17) a C'est abso^lument sûr \
b C'est absolu^ment
sûr \
La
Cm se produit donc à la position exigée par l'équilibre rythmique, le plus proche possible du milieu du groupe. Son
statut diffère donc radicalement de ceux des autres contours. Ceci
jette un doute sur la possibilité d'une hiérarchisation contrôlée de la
pertinence de l'information, ou de la profondeur de l'enchâssement
syntaxique, procédés postulés par de nombreux chercheurs.
• Contrainte
syntaxique n° 2: la règle de non séparation des têtes fonctionnelles et
lexicales
Les règles et contraintes présentées jusqu'ici génèrent pour (18) le découpage
eurythmique, qui n'est que très difficilement acceptable.
(18) ?? Jean-Michel a
souvent √ mangé du couscous \
/
- - - /
Ø -
- / -
-
/
Ø
- - /
Ce découpage est bien moins naturel que les découpages moins
eurythmiques (19 a) ou (19 b).
(19) a
Jean-Michel √ a souvent mangé du couscous \
b Jean-Michel a
souvent mangé √ du couscous \
On
note qu'en (18), à l'inverse de (19), l'auxiliaire 'a', une tête
syntaxique fonctionnelle, est séparé de 'mangé', la tête lexicale (ici
le verbe à la forme participiale) qui lui est associée (Fig. 4)
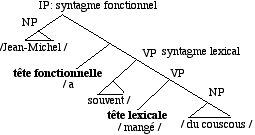 Fig. 4
Fig. 4
Cette constatation suggère la contrainte suivante :
Une tête fonctionnelle doit se
trouver dans le même groupe prosodique que la tête lexicale à laquelle
elle se rattache
Cette règle a une conséquence subtile lorsque le même énoncé est à un
temps non composé (20).
(20)
Jean-Michel mange souvent du couscous
En
syntaxe chomskyenne, on suppose qu'en français la tête lexicale verbale
se déplace (monte) vers la tête du syntagme fonctionnel lorsque cette
dernière est phonétiquement vide, ce qui est le cas aux temps non
composés (présent, imparfait, futur, etc.). Cette montée aurait pour
objet de fournir au verbe les marques morphologiques pertinentes. Selon
la théorie, l'élément qui monte laisse une trace phonétiquement vide t dans sa
position d'origine.
Ce phénomène de montée rend compte de la place apparemment variable de l'adverbe
'souvent' (ou 'pas') selon le temps (Fig. 5).
(18)
Jean-Michel a souvent mangé du couscous
(21)
Jean-Michel mange souvent t du couscous
/
-
- -
/
-
/ -
- / Ø
- -
/
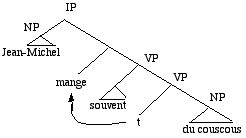 Fig. 5
Fig. 5
A nouveau, le découpage privilégié de (21) n'est pas le découpage
eurythmique (22)
(22)
??Jean-Michel mange √ souvent t du
couscous \
mais les découpages 'déséquilibrés' (23) ou (24)
(23)
Jean-Michel √ [mange souvent t ^ du
couscous ] \
(24)
[Jean-Michel v
mange souvent t ] √ du couscous \
L'application
de la règle exigeant que la tête fonctionnelle, contenant ici 'mange',
et la tête lexicale, ici réduite à 't', soient dans le même groupe rend
compte du fait que l'intonation naturelle est non eurythmique.
Cette
règle rend compte également de ce qu'on pourrait prendre à première vue
comme l'interdiction de la séparation d'un adjectif antéposé et du
substantif qu'il modifie.
(32) ?? J'ai rencontré un
immense √ cortège de manifestant \
[/Ø
- - - / Ø -
- /]
[/ - - / Ø -
- - -
/]
Bien qu'eurythmique et ne violant pas la règle du 'fils
droit et de l'oncle', ce découpage est nettement moins bon que le
découpage non eurythmique suivant :
(33) J'ai
rencontré un immense cortège √ de manifestant \
On
remarque qu'en (32) l'article indéfini 'un', une tête fonctionnelle,
n'est pas dans le même groupe que 'cortège', sur lequel il porte.
C'est, selon nous, la raison pour laquelle le découpage de (33) est
largement supérieur.
4 - L'accent
discursif du français
L'accent discursif marque le 'thème du discours' (ce dont on va parler) dans un énoncé rhématique.
Le
français utilise un véritable
accent initial de mot pour marquer un ou
plusieurs éléments d'un énoncé comme 'thème du discours'. Les phrases
en (25) pourraient introduire un journal télévisé régional. La syllabe
portant l'accent initial de mot est en gras.
(25) a Le Président de la
République a inauguré ce matin le nouvel hôpital de Nancy (Il a ensuite
présidé ...)
b Le Président de la République
a inauguré ce
matin le nouvel
hôpital de Nancy. (Il a été financé par...)
c Le
Président de la République a inauguré ce matin le nouvel hôpital de
Nancy. (C'est dans cette ville que ...)
d Le Président de la
République a inauguré ce
matin le nouvel hôpital de Nancy. (?)
e ....
L'absence de dislocation,
l'intonation 'ordinaire', et la valeur rhématique potentielle de (25)
indiquent sans ambiguïté que l'on est en présence d'une simple phrase
canonique, l'accent fournissant seulement la valeur de 'thème du
discours' à l'élément (ou les éléments) concerné(s). Avec
(25a) on
s'attend à ce que la suite du journal soit consacrée à la visite du
président, alors qu'avec (25b), le pronom anaphorique 'il' devrait
plutôt renvoyer à l'hôpital. On remarque en (25b) que la syllabe
accentuée est celle du premier mot lexical du groupe syntaxique.
On
peut noter trop de locuteurs (des enseignants pendant leurs cours par
exemple) abusent de ce marquage, en plaçant cet accent discursif
sur la plupart des mots lexicaux :
(33) Il est important de noter la marque du pluriel de ce mot
Il perd dans ce cas toute efficacité discursive.
5 - Quelques
notes sur les phrases non canoniques
• La topicalisation par
dislocation à gauche
(26) La crèche √+, Marie √+, son gamin
√+, elle l'y a mis dès la rentrée \
Cette
construction marque la topicalisation discursive d'un ou plusieurs
constituants, dans un ordre libre. Un topique est une entité à valeur
thématique introduite implicitement ou explicitement par un 'opérateur'
discursif comme 'quant à'. Le reste de l'énoncé (commentaire ou propos
à valeur rhématique) forme la phrase matrice (PhM) contenant le cas
échéant des pronoms résomptifs, énonçant une propriété concernant le ou
les topiques placés à gauche.
L'intonation des constituants topicalisés est la Continuation Majeure Forte
(CMF) (√+) qui se caractérise par
- Une ligne mélodique monotone quel que
soit le nombre de syllabes, à une
hauteur mélodique moyenne. La règle d'eurythmie ne s'appliquant pas, la
taille du constituant concerné est
libre
- Une montée mélodique marquée sur la
syllabe finale du groupe, avec rupture de la ligne mélodique.
- Une pause potentielle très souvent
réalisée, quel que soit le rythme d'élocution
• La dislocation à droite
Dans la dislocation à droite, la PhM est en tête, le ou les topiques
étant placés à sa droite.
(27) Elle
l'y a mis _ à la crèche, Marie, son gamin, cette année_
Cette
construction assure notamment des fonctions de correction ou de
désambiguïsation, mais n'est pas compatible avec l'opérateur de
topicalisation 'quant à'.
Un topique à droite est marqué par une Parenthèse Basse (_
..._) se caractérisant par
- Une ligne mélodique monotone quel que
soit le nombre de syllabes,
réalisée au niveau atteint par la dernière syllabe du groupe qui le
précède : dans une phrase affirmative, il s'agira
de la syllabe finale
du contour de finalité, donc de la base du registre du locuteur. La
règle d'eurythmie ne s'appliquant pas, la taille du constituant
concerné est libre.
- Une pause potentielle très souvent réalisée précède ce contour, quel
que soit le rythme d'élocution
• Les énoncés avec
focalisation
La
focalisation est une opération syntactico-discursive mettant en exergue
une information nouvelle, non présupposée ou non prédictible.
C'est
typiquement le cas de la partie rhématique d'une réponse à une
question. Il n'y a pas de structures syntaxiques ni de moyens
prosodiques exclusivement destinés à la focalisation.
Notre hypothèse est que la focalisation
implique le déplacement à gauche, vers une position structurale
spécifique, d'une partie de l'énoncé marquée par un trait syntaxique de
focalisation, le reste de l'énoncé étant automatiquement topicalisé. La
partie focalisé, étant rhématique, reçoit une contour de finalité, les
parties topicalisées se voyant assigné un contour de parenthèse basse.
On trouvera notamment des constituants focalisés dans
- des énoncés disloqués à
gauche, avec focalisation explicite par mouvement et
topicalisation de la PhM
(28) (Qui
est venu ?) Michel
\ _ il est venu _
- des énoncés
identificationnels, avec focalisation explicite par
mouvement et topicalisation
(29) (Qui Jean aime-t-il ?) _C'est_ Marie \ _ celle que
Jean aime _
- des phrases clivées,
avec focalisation explicite par mouvement et topicalisation
(30) (Avec qui Anne est-elle
allée en Egypte?) _C'est avec_ Michel
\ _ qu'Anne est allée en Egypte _
- des énoncés
non marqués
syntaxiquement avec focalisation in situ (sans
mouvement
explicite) et topicalisation
in situ du reste de l'énoncé
(31) (Qui
as-tu rencontré hier ?) _ J'ai rencontré _ Michel \ _ hier _
Bibliographie
(très sommaire !)
Lonchamp F. (1998) Notes
sur la syntaxe et l'intonation des constructions disloquées et
focalisées, Scolia,
11, 123 - 150
Lonchamp
F. (1998) Prédire
l'intonation d'une phrase affirmative: les facteurs
accentuels, rythmiques, syntaxiques et énonciatifs, Verbum, 17-1, 35 -
47.
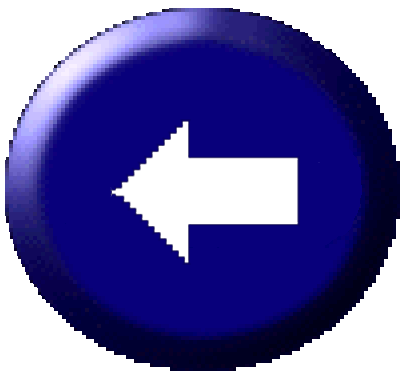 Retour à la page d'accueil
Retour à la page d'accueil
Version 1 : 19/07/2024
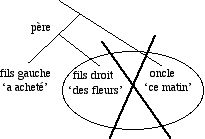 Fig. 1
Fig. 1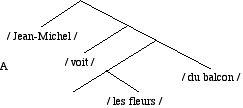 Fig. 2
Fig. 2
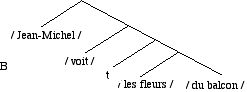 Fig. 3
Fig. 3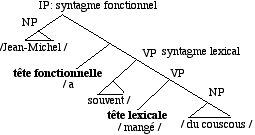 Fig. 4
Fig. 4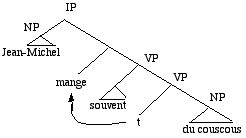 Fig. 5
Fig. 5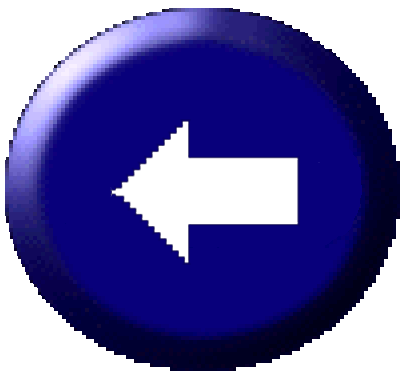 Retour à la page d'accueil
Retour à la page d'accueil